(Jur) CEDH : condamnation de la France pour intervention du GIPN et usage excessif de la force lors d’une interpellation
Le requérant est un ressortissant français qui se plaint d’avoir été victime de violences au cours de son interpellation à son domicile en présence de sa femme et de sa fille, par le GIPN. Il avait formé une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir une indemnisation du préjudice subi. Le tribunal considéra qu’en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant, l’État avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité et condamna l’État à payer la somme de 59 000 euros en indemnisation du préjudice subi, ainsi que 3 500 euros au titre du remboursement des frais. La cour d’appel confirma la recevabilité de l’action du requérant mais infirma le jugement pour le surplus et débouta le requérant de ses demandes. Il fut condamné à payer 1 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure pénale, outre les dépens. La Cour de cassation cassa l’arrêt et la cour d’appel de de renvoi considéra que la faute lourde, engageant la responsabilité de l’État, n’était pas démontrée s’agissant des conditions d’intervention du GIPN. Elle considéra qu’il ne pouvait être conclu à l’inutilité ou au caractère disproportionné de cette intervention en raison des actes accomplis par le requérant pour se défendre, mais aussi de sa persistance à se rebeller. En revanche, la cour d’appel jugea que l’État avait commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. L’État fut condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié à ce défaut de soins et à la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 précité. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.La Cour relève d’emblée que l’ensemble des certificats médicaux établis ont constaté que le requérant souffrait de blessures importantes : fractures d’une côte, du nez, du maxillaire droit, du cadre orbitaire, ainsi que de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps. Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale et ont entrainé des douleurs et une incapacité permanente partielle. L’expert désigné par le juge d’instruction a considéré que l’ensemble de ces blessures justifiaient une ITT de dix‑neuf jours.Outre les souffrances physiques que le requérant a dû supporter, la Cour considère que le traitement auquel il a été soumis a engendré des souffrances psychiques, ainsi qu’en atteste l’état de stress post-traumatique relevé médicalement. La manière dont s’est déroulée son arrestation, à savoir très tôt le matin à son domicile, après une ouverture forcée du portail et de la porte d’entrée, par de nombreux agents cagoulés et armés, devant sa compagne et sa fille, ont nécessairement provoqués de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches.S’agissant de la planification de l’opération, la Cour considère qu’en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d’un service plutôt qu’un autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, elle rappelle que l’intervention d’unités spéciales habituellement engagées dans des situations d’extrême violence ou particulièrement périlleuses exigeant des réactions promptes et fermes peut comporter des risques particuliers d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine. Elle considère que l’intervention de telles unités doit donc être entourée de garanties suffisantes.En l’espèce, l’opération d’interpellation dans laquelle le GIPN était principalement impliquée et pour laquelle son intervention avait été autorisée, répondait au but légitime d’effectuer une interpellation et poursuivait l’objectif d’intérêt général de la répression des infractions. Le but de l’intervention policière avec le concours du GIPN était, dans un premier temps, d’interpeller les membres d’une famille. Il ressort en effet des investigations menées par les autorités internes que le commandant avait demandé l’intervention de cette unité d’élite au juge d’instruction puis obtenu l’accord du directeur départemental afin d’interpeller, non pas le requérant, mais uniquement les membres d’une famille qui avaient déjà été condamnés pour violences et séquestration de fonctionnaire de police. Ce n’est qu’à la suite de l’interpellation de certains membres de cette famille que la commandante de police profita de l’opportunité de la présence du GIPN pour leur demander leur assistance dans l’interpellation du requérant, impliqué dans les mêmes faits, sans que le juge d’instruction ait été informé ni que le DDSP ait donné son accord. Partant, la Cour relève que cette opération n’a pas bénéficié des garanties internes existantes entourant normalement l’intervention de ce type d’unités spéciales.Concernant la personnalité du requérant, la Cour constate que les juges internes ayant statué en première instance sur la responsabilité de l’État, ont considéré que le caractère de dangerosité du requérant mis en avant pour justifier l’intervention du GIPN ne résultait que des déclarations des fonctionnaires de police ayant requis son intervention et n’était étayé par aucun élément probant. S’il n’est pas contesté que le requérant détenait des armes à son domicile, la Cour observe néanmoins que le tribunal correctionnel lui a restitué deux d’entre elles dont la possession sans autorisation n’était pas constitutive d’une infraction.Par ailleurs, la Cour relève que certaines juridictions internes ont, elles-mêmes, remis en cause la proportionnalité de l’intervention du GIPN au regard des circonstances de l’espèce. Elle constate que le tribunal correctionnel a jugé que l’intervention d’une unité spéciale telle que le GIPN dans une enquête pour menaces était peu commune et qu’à l’issue de l’interpellation mouvementée du requérant, celui-ci n’avait jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. La Cour observe également que si les juridictions internes n’ont pas retenu la responsabilité de l’État pour le choix de l’intervention du GIPN comme pour les violences qu’il a subies, la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il était « possible que ce choix ait été disproportionné par rapport au risque que faisait encourir le requérant ».Enfin, il ressort de la lecture des pièces du dossier qu’aucune investigation préalable afin de déterminer si le requérant serait seul au moment de son interpellation n’est alléguée. La présence éventuelle de la fille du requérant et de son épouse n’a donc pas pu être anticipée. Or la Cour estime que la présence éventuelle de membres de la famille du suspect sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opérations policières. Cela n’a pas été fait dans le cas d’espèce et les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile de la famille du requérant.La Cour considère, après avoir pris en compte toutes les circonstances particulières de l’espèce, que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée et exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale.S’agissant de l’usage de la force par les fonctionnaires de police, il n’est pas contesté, d’une part, que les lésions constatées sur le requérant ont été causées par les policiers qui ont procédé à son interpellation et, d’autre part, que le requérant a frappé l’un d’entre eux avec une barre de fer. Le requérant et le Gouvernement n’ont cependant pas la même version du déroulement des faits. Le requérant affirme qu’il ignorait qu’il s’agissait des forces de police au moment où il a frappé l’un d’entre eux. Le Gouvernement soutient que le requérant ne pouvait ignorer qu’il s’agissait des forces de police et qu’il a sciemment frappé l’un des policiers puis, qu’il s’est rebellé et a continué à se montrer violent.La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet. Or, la Cour note que le tribunal correctionnel a jugé, par une décision devenue définitive, que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile et qu’il avait agi en état de légitime défense.En conséquence, la Cour ne peut retenir la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant aurait sciemment agressé les forces de l’ordre ce qui ne ressort que des affirmations des policiers impliqués dans les faits litigieux et mis en cause, à l’exclusion de tout autre élément de la procédure. Par ailleurs, les éléments de preuve dont elle dispose ne permettent pas à la Cour de déterminer si, après qu’il eut compris qu’il s’agissait des forces de l’ordre, le requérant a persisté à se rebeller ou non. Elle constate néanmoins, d’une part, qu’il n’a pas été poursuivi pour des faits de rébellion et, d’autre part, que les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers ont été particulièrement violents. La Cour observe, en effet, que les policiers ont décrit ainsi le mode opératoire utilisé pour interpeller le requérant : percussion au niveau du visage, utilisation de la force jusqu’à la mise au sol, retournement et plaquage sur le ventre au moyen de pressions des genoux et des coudes exercées au niveau du cou, du dos et des jambes du requérant puis menottage dans le dos. Ces éléments ajoutés aux multiples fractures et hématomes constatés sur l’ensemble du corps du requérant attestent de l’intensité de la force physique dont il a été fait usage à son encontre.Ces considérations permettent à la Cour de conclure que les moyens employés n’étaient pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et que la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été rendue telle par son comportement.Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

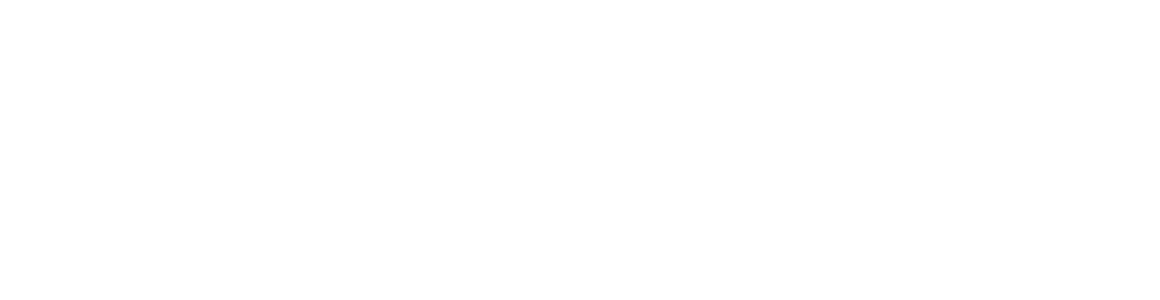
![Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas [I]pro-cedere[/I]](https://billion-avocat-montpellier.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/xdummy-transparent-re5yehp40lt7dvexl9rpw5g1u3ulggmtyx5gc0w9i0.png.pagespeed.ic.aafiGtW5S0.png)
![Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas [I]pro-cedere[/I]](https://billion-avocat-montpellier.com/wp-content/uploads/2017/07/xcontacts-pic-150x150.jpg.pagespeed.ic.WiMNY-Bi_E.jpg)


